Suite à notre article sur les 8 bonnes raisons d’étudier Alabama 1963 au lycée, une professeure de français nous a demandé des pistes pour étudier avec ses élèves un autre de nos romans : America[s] !
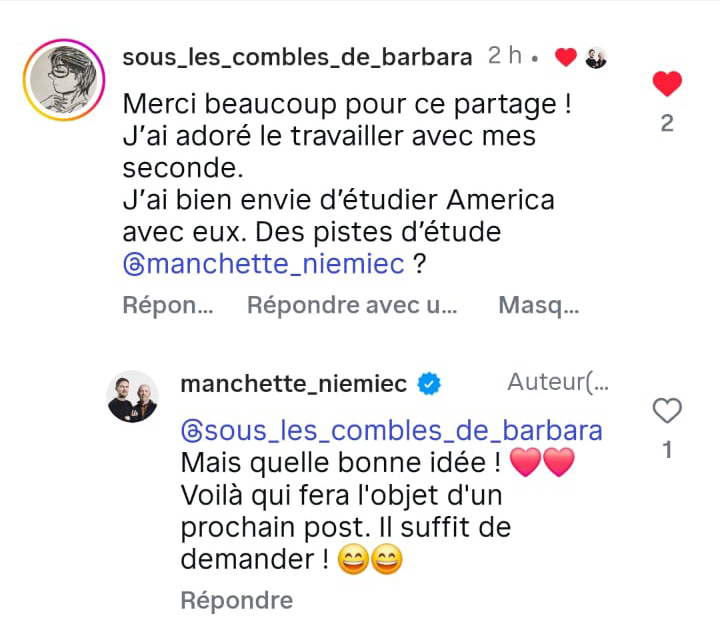
Il n’y a qu’à demander ! 
 Nous n’y avions pas pensé, mais il est vrai que notre deuxième roman, accessible tout en étant riche, peut facilement se prêter à une étude littéraire grâce à ses différents niveaux de lecture. Jugez plutôt…
Nous n’y avions pas pensé, mais il est vrai que notre deuxième roman, accessible tout en étant riche, peut facilement se prêter à une étude littéraire grâce à ses différents niveaux de lecture. Jugez plutôt…
1. Récit initiatique
America[s] est un roman d’apprentissage, dans lequel on suit non seulement la quête d’Amy (retrouver sa sœur), mais aussi une quête intérieure.
Pourquoi pas étudier la construction du personnage principal : ses épreuves, ses rencontres, les signes de son évolution ? En le comparant, par exemple, à d’autres figures adolescentes en quête d’identité (Holden Caulfield de L’Attrape-cœurs, Alice au pays des merveilles, Dorothy du Magicien d’Oz…).
Activité possible : réécrire un passage de ce « journal de bord » d’Amy à la troisième personne du singulier et/ou au passé et observer ce que cela change dans l’implication du lecteur. (On a essayé au moment de l’écriture et on est revenus au « je » et au présent. Pourquoi, à votre avis ? 
 )
)
2. Un conte moderne
Essayer d’identifier les clins d’œil aux contes traditionnels en général (prince charmant, grand méchant loup, château, etc.) et à Alice au pays des merveilles en particulier.
Le personnage de Lorraine n’est-il pas une figure de bonne fée ? (Indice : si ! 
 ) Quelles sont les autres bonnes fées du roman (elles sont nombreuses). Certains personnages sont plus ambivalents, mais ne le sommes-nous pas tous ? Bonne dissertation ! Vous avez quatre heures.
) Quelles sont les autres bonnes fées du roman (elles sont nombreuses). Certains personnages sont plus ambivalents, mais ne le sommes-nous pas tous ? Bonne dissertation ! Vous avez quatre heures.

3. L’Amérique des années 70 : entre réalité et mythe (oh là là, ça fait sérieux ! 
 )
)
America[s] est un bon moyen de croiser littérature et Histoire / culture américaine ! On vous rappelle le contexte : guerre du Vietnam, Watergate, fin du mouvement hippie, ségrégation toujours présente. Dit comme ça, c’est pas la joie, mais le livre est drôle quand même…
Il s’agit aussi d’une chronique historique, dans laquelle on explore le mythe américain du voyage. (On y trouve d’ailleurs quelques clins d’œil à Sur la route de Kerouac ou Easy Rider…)
On peut d’ailleurs imaginer un travail transversal avec les professeurs d’anglais et d’histoire. Allez hop, on met tout le monde dans la sauce ! 

4. La contre-culture et les marges
Parmi nos personnages secondaires : un vétéran de la guerre du Vietnam, des hippies, un couple en cavale, une personne transgenre… Des marginaux. Des figures de liberté et/ou d’errance.
Ça peut être l’occasion de réfléchir sur la norme, la société de consommation, la désobéissance, les idéaux de paix.
Question : quel personnage annonce l’arrivée prochaine des années 80 et de son capitalisme triomphant ? (Indice : l’autostoppeur ! 
 )
)
Débat en classe : la liberté justifie-t-elle la transgression des règles ? (À notre avis, oui, mais on serait curieux de savoir ce qu’en pense la jeunesse.)
5. La langue et le style : un roman qui se lit comme on regarde un film
Étudier l’écriture : visuelle, rythmée, cinématographique (ce n’est pas nous qui le disons, c’est tout le monde !).
Analyser la construction des dialogues, des descriptions, des effets de montage.
Projet créatif : écrire une scène inédite, comme un scénario. Puis la réécrire dans le style du roman. Observer les différences. (Laisser refroidir. Déguster. 
 )
)

6. Figures féminines et émancipation
Le parcours d’Amy est une quête de la sœur mais aussi de soi (on l’a déjà dit, mais ça va bien ici aussi et c’est important) durant lesquelles elle va croiser de nombreuses figures féminines.
Angle d’étude : Lorraine et les autres femmes croisées comme autant de modèles alternatifs.
Autre idée : une réflexion sur la condition féminine dans les années 70 (représentation de la femme dans la société, Playboy, rapport aux hommes et au mariage…).
(On vous l’avait dit que le roman était riche !)
7. Intertextualité et clins d’œil culturels
Vous aurez noté des références à la culture pop (Bruce Springsteen, les Carpenters et la musique en général, le cinéma et la télévision de l’époque).
Question : que disent ces clins d’œil du roman et de son regard sur l’adolescence ?
On peut aussi citer et étudier les références littéraires convoquées : Jack Kerouac, J.D. Salinger, Lewis Carroll…
Exercice oral : présenter (peut-être à deux, c’est toujours plus sympa ! 
 ) l’une des œuvres référencées dans le roman.
) l’une des œuvres référencées dans le roman.
*
Et voilà le travail ! Bien sûr, ce n’est pas exhaustif. Ce ne sont que quelques pistes à creuser si vous travaillez America[s] en classe.
À vous de jouer maintenant ! 


